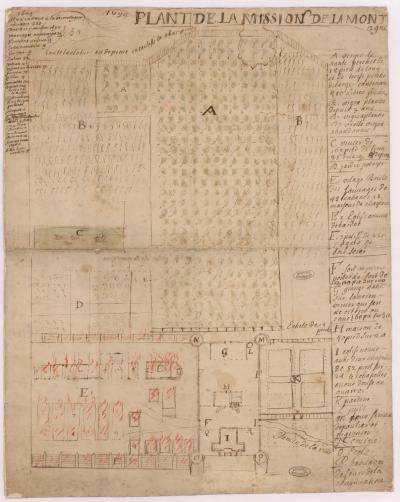« L’âme éternelle de la vieille Chine danse, la nuit, dans la ville chinoise de Montréal. » La Revue Moderne évoque ainsi, en 1937, un espace exotique toujours bien connu des Montréalais.
Quartier chinois

C’est ainsi que se crée le Chinatown, un lieu où ces hommes pouvaient s’unir face à la discrimination et constituer des réseaux sociaux utiles. À la fin du XIXe siècle, près de 500 Chinois habitent à Montréal. Concentrés autour des rues Saint-Laurent, Saint-Urbain et De La Gauchetière, ils choisissent ce secteur pour sa vitalité commerciale, pour ses loyers abordables, mais aussi pour son caractère multiculturel. À l’époque, juifs, Irlandais, francophones et anglophones s’y côtoient déjà. L’espace devient vite une véritable terre d’accueil pour les immigrants chinois : on parle pour la première fois du Chinatown de Montréal dans le quotidien La Presse en 1902. L’arrivée des Chinois contribue à faire de Montréal une mosaïque ethnique.
Une vie nocturne attractive
Quartier chinois

À l’époque, le Chinatown, lieu de divertissements, est aussi visité régulièrement par la police. Plusieurs bâtisses, vieilles et délabrées, abritent des maisons de jeu, et des réseaux criminels y sont souvent formés. Les journaux couvrent à plusieurs reprises les véritables guerres que se livrent les différentes sociétés et groupes du quartier. Ces organisations, appelées Tong (littéralement « salle » ou « hall » en mandarin), entretiennent entre elles de vives rivalités. En 1922, The Quebec Daily Telegraph rapporte une dispute territoriale entre les Wong et les Hum au sujet d’une vente d’opium. Les deux camps en vont jusqu’aux armes et plusieurs sont blessés par balle. En 1933, une autre Tong War, opposant des factions politiques, éclate dans les rues du Chinatown. Les violences sont telles que, en 1936, dans le journal La Patrie, le Quartier chinois est décrit comme un lieu où « la vendetta n’attend qu’une étincelle pour éclater ». Les troubles dureront jusque dans les années 1940.
Chinatown, un quartier symbolique
Quartier chinois

Par ailleurs, dans les années 1950-1960, la Ville entreprend de grands projets d’élargissement des rues et de revitalisation urbaine. Résultat, la taille du Chinatown est réduite de près d’un tiers de sa superficie. Les nouveaux projets viennent également définir les limites spatiales du Chinatown tel qu’on le connait aujourd’hui. Durant les années 1970, le quartier fait face à un renouvellement urbain dicté par les autorités municipales. Les grands projets résidentiels et urbains de la Ville (le Complexe Guy-Favreau, l’autoroute Ville-Marie, le Palais des congrès…) annoncent la démolition du parc de la Pagode, de trois églises chinoises, de plusieurs commerces ethniques et d’un secteur résidentiel entier. Malgré les protestations qui émergent au sein de la communauté, la plupart des projets voient le jour, et seule l’église catholique chinoise est sauvée.
Des installations urbaines chinoises
Quartier chinois

Le Chinatown de Montréal est le « plus chinois » de ses pairs au Canada. C’est-à-dire qu’il est habité presque uniquement par des immigrants en provenance de Chine. En 2011, le nombre d’immigrants venant de Chine est estimé à près de 30 000, représentant 4,6 % de la population montréalaise; ils sont cependant maintenant étalés sur l’espace montréalais, avec une forte présence dans les quartiers Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce et Saint-Laurent. Si le Quartier chinois a désormais une superficie et une population moindres, il conserve son importance symbolique pour la communauté chinoise de Montréal.
Collaborateur à la recherche et à la rédaction : Matthieu Caron.
Durant la première décennie du XXIe siècle, un nouveau quartier chinois apparait dans l’ouest de la ville tout près de l’Université Concordia (d’où son autre nom, Concordia Chinatown), entre les rues Bishop et Fort, et les rues René-Lévesque et Sherbrooke. Tout comme dans le premier Chinatown, on y trouve de la cuisine asiatique, notamment des spécialités japonaises, chinoises, coréennes et même d’Asie du Sud-Est.
De nombreuses entreprises chinoises s’y sont installées, particulièrement dans la rue Sainte-Catherine. La plupart des résidants du secteur sont des immigrants et des étudiants venus de Chine et d’Asie du Sud-Est. Par ailleurs, le consulat général de la République populaire de Chine est situé tout près, au 2100, rue Sainte-Catherine Ouest.
CHA, Jonathan. « La représentation symbolique dans le contexte de la mondialisation : L’exemple de la construction identitaire du quartier chinois de Montréal », Journal of the Society for the Study of Architecture in Canada / Journal de la Société pour l’étude de l’architecture au Canada, 29, nos 3, 4, 2004, p. 3-18. En ligne : patrimoine.uqam.ca/upload/files/publications/CH.pdf
CHAN, Kwok B. Smoke and Fire: The Chinese in Montreal, Hong Kong, The Chinese University Press, 1991.
HELLY, Denise. Les Chinois à Montréal : 1877-1951, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1987.
LACROIX, Fernand. « Rendez-vous chinois dans Montréal », La Revue moderne, Montréal, mars 1937.
LEI, David Chuenyan, et Timothy Ciu Man CHAN, « Le Quartier chinois de Montréal, des années 1890s à 2014 », [En ligne], Quartiers chinois du Canada Série, Burnaby, Simon Fraser University, 2015.
http://www.sfu.ca/chinese-canadian-history/PDFs/Montreal-FrChi-WebFinal.pdf
MORRISON, Val M. Beyond Physical Boundaries: The Symbolic Construction of Chinatown, Mémoire (M.A.), Montréal, Université Concordia, 1992.
蒙特利尔唐人街诞生于19世纪后期,当时一群铁路工人从不列颠哥伦比亚省来到蒙特利尔寻找工作机会。面对歧视问题,他们自发组成了一个社区。这些华人与其他犹太裔和爱尔兰移民社区一样,被迫在Saint Laurent街、 Saint-Urbain街和 De La Gauchetière 街附近定居,因为这一区域租金低廉。由于受到歧视而难以被雇用,华人移民便纷纷开设了洗衣店、商店和餐馆。尽管遇到了种种障碍,但此类小生意仍然增长迅速。
1947年之后,被禁止了将近25年的华人再次被允许移民加拿大。一批新移民的到来使得正在老化的华人群体恢复了生气。然而,富裕的新移民通常定居在唐人街之外,本来主要是住宅区的唐人街成为了具有象征性的旅游景点。与威胁唐人街的政府项目抗争了无数次之后,华人社区与市政府于1980年代初连手重振唐人街。在Saint-Laurent 大道上著名的拱门和中山公园就此诞生了,这些都是今天唐人街主要的组成部分。可是,反对仕绅化和种族歧视的抗争仍在持续。
—
Traduction en chinois simplifié : Serena Xiong et révision (chinois simplifié) : Philippe Liu.
滿地可唐人街誕生於19世紀後期,當時一群鐵路工人從卑斯省到了找工作。因為面對歧視,此群工人組成了一個社群。這些華人與其他猶太裔和愛爾蘭移民社群一樣,因為該區租金低廉,被迫在Saint Laurent街、 Saint-Urbain街和 De La Gauchetière 街附近定居。由於歧視而難以被僱用,華人移民開設了洗衣店、商店和餐館。儘管遇到障礙,此類商業仍然迅速增長。
1947年之後,被禁止了將近25年的華人再次被允許移民加拿大。一批新移民促使正在老化的華人人口恢復生氣。然而,富裕的新移民通常定居在唐人街之外,本來主要是住宅區的唐人街成為具象徵性的旅遊景點。與威脅唐人街的政府項目抗爭了無數次之後,華人社群與市政府於1980年代初聯手重振唐人街。在Saint-Laurent 大道上著名的拱門和中山公園就此誕生了,這些都是今天唐人街的主要一部分。可是,反仕紳化和種族歧視的抗爭仍然持續。
—
Traductrice : Wai Yin Kwok.
Avant-après : Quartier chinois


Rue de la Gauchetière Est
1945. Parade. Chinatown Celebrates [la communauté chinoise célèbre le jour de la Victoire par un défilé dans les rues du quartier chinois], par Conrad Poirier. Bibliothèque et Archives nationales du Québec. P48, S1, P12333.
2014. Rue de la Gauchetière dans le quartier chinois, par Denis-Carl Robidoux. Centre d’histoire de Montréal.