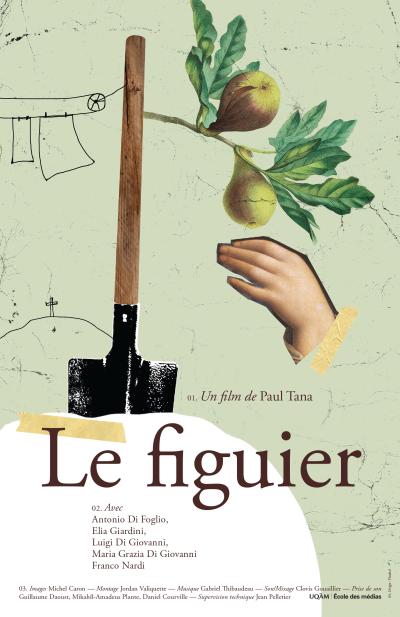La société occidentale des années 1960 connaît un véritable bouillonnement politique, social, culturel. Comme ailleurs dans le monde, les jeunes Québécois aspirent à de grands changements.
Émeutes raciales aux États-Unis, protestations contre la guerre du Vietnam, assassinats de Che Guevara, de Martin Luther King et de Robert Kennedy, guerre froide, bombes du Front de libération du Québec…
« Une révolution qui aurait dû prendre 50 ans s’est faite en 5 ans! En tant que jeune, il fallait s’agripper, sinon on perdait les pédales. » — Germaine Ying Gee Wong, 18 ans en 1968
McGill français

À la fin de cette décennie, la télévision, les journaux et la radio exposent jour après jour une planète en plein bouleversement, parfois sur le bord de l’éclatement. Au Québec, les revendications sociales, laïques et culturelles mènent à la création d’un État moderne. Cependant, les tensions commencent à fissurer l’image unidimensionnelle d’un peuple et de sa métropole en apparence paisibles. Sur un fond de guerre froide et de menace communiste, la période d’après-guerre est marquée par des valeurs traditionnelles et conservatrices dont la nouvelle génération québécoise souhaite se libérer. Ces jeunes du baby-boom sont exposés aux conflits internationaux grâce, notamment, à la télévision qui fait son apparition dans les années 1950 dans la métropole, et ils réclament un monde nouveau.
Le Québec bouillonne. La Révolution tranquille n’est, justement, pas toujours tranquille, comme en font foi les actes du Front de libération du Québec. Les jeunes prennent position, contestent, manifestent. Expo 67 cristallise les changements multiples et profonds de cette décennie.
Guerre du Vietnam (1957-1975)
De 1957 à 1975, le conflit oppose les communistes du Vietnam du Nord à l’armée sud-vietnamienne, soutenue militairement par les États-Unis entre 1965 et 1973. En Occident, les manifestations se multiplient pour contester cet engagement. Le Sud est finalement défait en 1975.
Guerre froide (1945-1989)
La guerre froide désigne la période de tensions entre les États-Unis, l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) et leurs alliés respectifs. De la fin de la Deuxième Guerre mondiale (1945) jusqu’à la chute du mur de Berlin (1989), cette rivalité idéologique est marquée, entre autres, par une course à l’armement nucléaire et à la conquête de l’espace.
Front de libération du Québec (1963-1970)
Formé en 1963, ce groupe révolutionnaire souhaite obtenir l’indépendance du Québec par la lutte armée. Le FLQ est responsable de plusieurs actes terroristes à visée politique, dont plus de 200 attentats à la bombe, et de la mort du ministre Pierre Laporte lors de la crise d’Octobre en 1970.
Mai 68 (mai et juin 1968)
Mai 68 désigne une série de grèves générales et de manifestations survenues en France en mai et juin 1968. Enclenché par des révoltes étudiantes, le mouvement gagne la classe ouvrière puis rapidement une partie importante de la population. Cette crise sociale se traduit principalement par des contestations dirigées contre le capitalisme et les valeurs traditionnelles.
Crise des missiles de Cuba (du 16 au 28 octobre 1962)
La crise des missiles de Cuba représente un moment charnière de la guerre froide amorcé par l’implantation secrète de missiles nucléaires soviétiques à Cuba. Les États-Unis et l’URSS, au bord de la guerre nucléaire, entament des négociations qui mènent finalement au retrait des missiles.
Guerre des Six Jours (du 5 au 10 juin 1967)
Le conflit naît des tensions entre l’État d’Israël et une coalition de quatre pays arabes : l’Égypte, la Jordanie, la Syrie et l’Irak. La guerre est déclenchée le 5 juin 1967 par Israël qui prévoit une attaque imminente des troupes égyptiennes, déjà mobilisées à sa frontière. Après six jours de combats, les forces israéliennes conquièrent, entre autres, le désert du Sinaï, la bande de Gaza et Jérusalem-Est.
Printemps de Prague (du 5 janvier au 21 août 1968)
Le printemps de Prague désigne une série de réformes libérales menées en 1968 par le gouvernement communiste tchécoslovaque. En désaccord avec cette nouvelle politique, les autres pays communistes d’Europe de l’Est, menés par l’URSS, interrompent ces réformes en envahissant la Tchécoslovaquie. La population n’oppose pas de résistance armée, et un retour au socialisme traditionnel lui est imposé.
Loi 63 (29 novembre 1969)
Au Québec, pour protéger la langue française, on prévoit de l’imposer aux immigrants dans les écoles. Cette proposition fait réagir, notamment, la communauté italienne de Saint-Léonard qui proteste contre l’abolition des classes bilingues. La loi 63, qui permet aux parents de choisir la langue d’enseignement de leurs enfants, est donc instituée, malgré le vif désaccord d’une partie de la population francophone.
McGill français (28 mars 1969)
La manifestation « McGill français » rassemble plus de 10 000 jeunes militants devant l’université anglophone. Ces derniers souhaitent que McGill devienne accessible aux Québécois francophones et à la classe ouvrière. L’Université de Montréal, seule université francophone de la métropole, n’arrive plus à composer avec le grand nombre d’étudiants. L’ouverture de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), la même année, calmera les esprits et assurera aux jeunes francophones de la région un meilleur accès à l’enseignement supérieur.