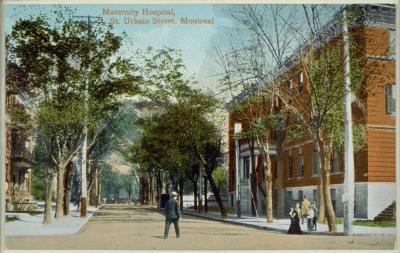Les fondateurs de compagnies de taxi ont imprégné l’histoire du taxi à Montréal, mais un homme s’est distingué par son apport exceptionnel aux chauffeurs. On l’appelait le « Bon Dieu en taxi ».
« Au beau milieu de la dernière guerre, un jeune prêtre volubile et costaud, Paul Aquin, rêvait d’être missionnaire en Chine. Or, il allait plutôt devenir le fondateur de la mission la plus inusitée en Amérique du Nord, dans les roulottes du “Bon Dieu en taxi” auxquelles Life Times, Paris Match, consacrèrent articles et photos. » — Pierre Léger, Photo-Journal
Le Bon Dieu en taxi

Pour réaliser ce projet qu’il mijote depuis 1954, le père Paul Aquin obtient d’abord l’appui du cardinal Paul-Émile Léger, puis se met à la recherche du meilleur moyen d’atteindre les chauffeurs là où ils sont, sans qu’ils aient à se déplacer à l’église. Son expérience d’aumônier chez les pompiers, puis au pénitencier Saint-Vincent-de-Paul, lui rappelle l’importance d’un apostolat direct et adapté aux croyants. Après avoir sondé le terrain auprès de l’industrie, il est convaincu qu’un soutien pastoral propre aux chauffeurs de taxi de Montréal est la meilleure voie à suivre. Pour mener à bien sa mission apostolique originale, qui lui permettra de desservir exclusivement dans ce milieu, il imagine construire une sorte de roulotte-église dans laquelle il pourrait célébrer des messes diurnes et nocturnes et joindre directement les fidèles dans leur paroisse.
« Puisque les garages sont ouverts jour et nuit au service des voitures, plaide le père Aquin, pourquoi ne ferions-nous pas la même chose au service des âmes ? » — Pierre Léger, Photo-Journal
Propager la foi moderne dans une église ambulante
Le Bon Dieu en taxi intérieur

L’œuvre du Bon Dieu en taxi est si populaire qu’une deuxième roulotte est rapidement nécessaire pour soutenir sa mission religieuse. Assemblée par la General Coach Works of Canada selon les indications du père Aquin, la « roulotte-cathédrale », comme il l’appelle, arrive tout droit de l’Ontario à Montréal en 1959. Sa longueur de 55 pieds en fait la plus grande remorque jamais construite au Canada. On ne peut pas la manquer : ornée de vitraux des deux côtés, elle arbore un affichage bilingue, « le Bon Dieu en taxi » et « Taximan’s Mobile Church ». Elle peut accueillir 60 personnes assises et 125 debout. Toutefois, la plupart des fidèles (200 000 en à peine deux ans, jusqu’à environ 450 000 en 1964), qui ne conduisent pas tous des taxis, apprécient la possibilité d’écouter la messe amplifiée par des haut-parleurs placés à l’extérieur, dans le confort de leur voiture. Ceux qui souhaitent communier signalent leur intention avec leurs phares. Il faut dire que la mission est ouverte à tous. D’autres catégories de travailleurs fréquentent les roulottes qui sont ouvertes de 11 h 40 du matin à 4 h dans la nuit. On pense aux employés de radio et de télévision, des clubs de nuit, des hôtels, aux chauffeurs de camion, etc.
Une organisation efficace
Le Bon Dieu en taxi rue Rachel

Une troisième roulotte surnommée « SteinGod », en référence à la chaîne d’alimentation Steinberg, s’ajoute en 1961. Elle contribue à nourrir les ambitions sociales du révérend puisqu’elle sert à distribuer des secours alimentaires aux nécessiteux, sans tenir compte de leur croyance religieuse. Enfin, une quatrième roulotte vouée à l’assistance sociale est aménagée pour loger le personnel de la paroisse ambulante et servir de bureau d’aide aux personnes ayant besoin d’une assistance financière immédiate.
D’abord célébrées au parc La Fontaine, les messes du Bon Dieu en taxi sont dites au parc Jeanne-Mance, tandis que la roulotte géante de la chapelle-cathédrale est installée près du monument George-Étienne Cartier au pied du mont Royal, sur l’avenue du Parc. En 1961, les roulottes migrent sur la rue Rachel, en face des usines Angus, puis, en 1962, sur un terrain avoisinant le centre commercial Maisonneuve, rue Sherbrooke Est. L’œuvre cesse d’être itinérante afin de ne plus perdre de temps en déplacements quotidiens.
Ascension et financement des activités
Le Bon Dieu en taxi 1960

Déclin et fin du Bon Dieu en taxi
Le Bon Dieu en taxi 1969

Le père Paul Aquin décide de prendre des vacances avec la permission du diocèse et d’accepter d’autres fonctions au sein de la Compagnie de Jésus. Pour pallier son absence, l’Archevêché nomme le père dominicain Pierre Tremblay, collaborateur immédiat du père Aquin, comme aumônier du taxi, lequel occupera un bureau dans les locaux d’entreprises de taxi. Les célèbres roulottes n’étant plus, le cœur de l’œuvre s’est étiolé. La mission du Bon Dieu en taxi s’achève définitivement en 1970.
R.P. est l’abréviation de révérend père, titre honorifique donné aux prêtres des ordres religieux chrétiens.
Les abréviations R.R. et P.P. indiquent une séquence de plusieurs noms d’aumôniers dans une phrase.
S.J. (ou s.j.) est un sigle signifiant « Societas Jesu ». Il désigne l’ordre religieux de la Compagnie de Jésus. Placé après un nom, il indique que la personne est un jésuite.
CHISHOLM, Lauchie. « Oddest Parish Gets Bigger Chapel: Taximen’s Chaplain Santa, Too », The Gazette, 3 janvier 1959, Archives de la Ville de Montréal.
CRÊTE, Maurice. « Les chauffeurs de taxi ont maintenant leur aumônier », Le Devoir, 18 janvier 1957, Archives de la Ville de Montréal.
DE LA ROCHELLE, Serge. « Une paroisse mobile pour les chauffeurs de taxi de Montréal », La Presse, 8 janvier 1957, Archives de la Ville de Montréal.
PILON-LAROSE, Hugo. « Le Bon Dieu en Taxi : le renouveau liturgique provoque un grand dérangement », La Presse, 1er mars 1965, Archives de la Ville de Montréal.
LAPERRIÈRE, Guy. « L’Église au Québec », dictionnaire Usito, Université de Sherbrooke, dernière mise à jour 21 janvier 2025.
LÉGER, Pierre. « Le Bon Dieu en taxi, c’est une vie de fou », Photo-Journal, semaine du 30 septembre au 7 octobre 1964, p. 4-5, Archives municipales de Montréal 1273, dossier conservé dans la collection Taxi. Le Bon Dieu en taxi.
PRESSE CANADIENNE. « La plus grande roulotte au Canada. Nouvelle roulotte au Bon Dieu en taxi », La Presse, 21 novembre 1958, Archives de la Ville de Montréal.
PRESSE CANADIENNE. « Ayant dépassé ses cadres… Le Bon Dieux en taxi s’adressera désormais à un plus grand nombre », La Presse, 29 juin 1960, Archives de la Ville de Montréal.
SARRAULT, Jean-Paul. « Les golfeurs paieront $100 pour aider l’œuvre du Bon Dieu en taxi », Montréal Matin, 18 juillet 1961, Archives de la Ville de Montréal.
SHOETERS, Jean. « Paul Aquin – Le Bon Dieu en Taxi », Montréal Taxi Blog, 19 avril 2008.
SHOETERS, Jean. « Le Bon Dieu en Taxi – Paul Aquin (1959-1965) », Montréal Taxi Blog, 18 janvier 2023.
RADIO-CANADA. Il y a 55 ans, l’Église catholique abandonnait la messe en latin, RADIO-CANADA Archives, 6 mars 2020.
RDS. Il était une fois, le Père Paul Aquin, RDS, 5 janvier 2009.
WARREN, Jean-Philippe. Histoire du taxi à Montréal. Des taxis jaunes à UberX, Les Éditions du Boréal, 2020, 432 p.
Article « R.P. », WIKTIONNAIRE, Le dictionnaire libre.
Article « S.J. », WIKIPÉDIA, L’encyclopédie libre.
« Un merci à LA PRESSE et des précisions du P. Paul Aquin », La Presse, 9 décembre 1959, Archives de la Ville de Montréal.
« Le Bon Dieu en taxi s’en va… chez le diable! », Journal de Montréal, 19 octobre 1966, Archives de la Ville de Montréal.
« Le public ne sera plus admis aux messes de nuit du Bon Dieu en taxi. », Dimanche-Matin, 14 décembre 1966, Archives de la Ville de Montréal.
« Le Bon Dieu en taxi : À partir du 15 janvier, le père Aquin ne chantera plus de messes en public », Dimanche-Matin, 2 octobre 1966, Archives de la Ville de Montréal.
« Le père Paul Aquin quitte son œuvre du Bon Dieu en taxi. », La Presse, Dimanche-Matin, 4 mai 1969, Archives de la Ville de Montréal.